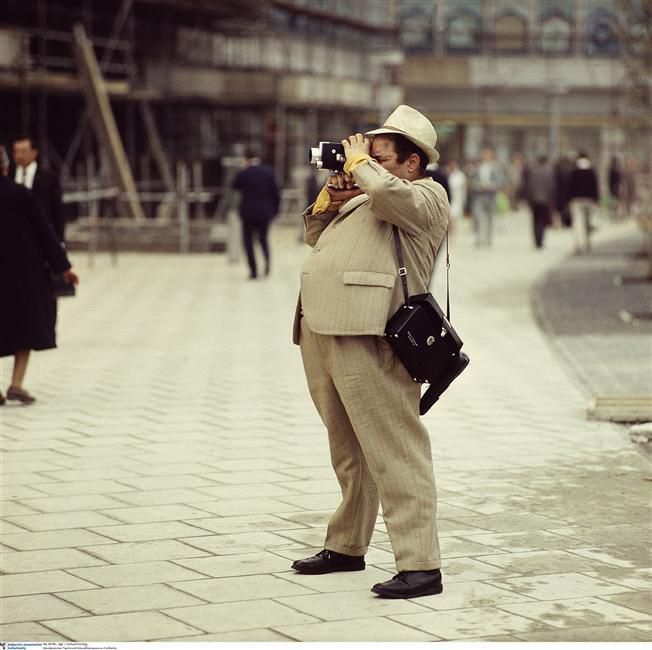Comme les livres, quoi....
« Ah bon, c’est payant ? Dans ce cas je renonce à m’inscrire ». C’est la litanie qu’entendent quotidiennement les discothécaires de la Ville de Paris qui exercent dans les vingt (chiffres indicatif) bibliothèques municipales de la capitale qui abritent encore des collections de phonogrammes (en majorité sous forme de Compact Disc mais aussi en vinyle). Car oui, si les bibliothèques de la Ville de Paris sont gratuites, c’est, pour les adultes, uniquement pour les collections imprimées car pour emprunter de la musique il faut débourser la somme de 30,50 euros. Une pratique dénoncée jusque dans un rapport commandé par….. la mairie de Paris elle-même !
« Il est incompréhensible de voir coexister dans un même lieu des documents gratuits d’un côté (des livres) et payants de l’autre (des CD ou des DVD) » pointait ce rapport rédigé en 2015 par Gilles Rettel. Il est vrai que cette différence de traitement entre supports documentaires porteurs d’une mission commune de diffusion culturelle ne se justifie en aucune façon. Il ne faut pas abandonner le prêt physique » car le CD (ou le vinyle) a « un impact sensitif » rappelle encore Giles Rettel pour qui « la dématérialisation est un mythe ». D’ailleurs, la production de disque reste encore plutôt élevée dans l’industrie de la musique avec ses milliers de parutions mensuelles, tous genres confondus, disponible en magasin ou sur les sites des musiciens et des maisons de disques.
Une position reprise par l’Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale (ACIM) laquelle avait publié le manifeste la musique a toute sa place en bibliothèque pour réaffirmer le rôle prépondérant des médiathèques dans le développement de l’éducation et de la culture musicale de tous les publics, et notamment des nouvelles générations laquelle passe donc par la gratuité de l’abonnement pour emprunter dans les sections discothèques des bibliothèque de la capitale
Si la mairie de Paris pourra rétorquer qu’elle a exonéré de cet abonnement les mineurs et les adultes aux minima sociaux, elle oubliera en revanche de préciser que ce système a été totalement détourné de son objet initial. En effet, il est très fréquent de voir des CSP+ qui en ont les moyens emprunter des documents sonores (et aussi des DVD) gratuitement avec la carte de leurs enfants mineurs après les avoir inscrit avec un accès « tout documents adultes ». Finalement les seuls qui doivent continuer à payer pour emprunter de la musique (ou des DVD), car ne pouvant pas trouver d'artifice, sont les usagers majeurs sans enfants qui déclarent un revenu à partir du SMIC ce qui
C’est pourquoi nous, professionnels des bibliothèques parisiennes, demandons à nouveau que la mairie de Paris instaure la gratuité de tous les supports musicaux, comme pour les collections imprimées, à tous les usagers sans distinction, pour permettre un véritable accès à la culture et une véritable égalité de traitement.
Premiers signataires (par ordre alphabétique) : Jeanne Ahdab (François Villon-Xe), Ismène Alessandri (MMP-Paris Centre), Nicolas Almimoff (Jacqueline de Romilly-XVIIIe), Sofia Arpal-Moya(Marguerite Duras-XXe), Abdoulaye Barry (Marguerite Duras-XXe), Florent Belser (MMP-Paris Centre), Maïlys Bion (Marguerite Audoux-IIIe), David Bonilla (Hergé-XIXe), Marielle Bonnabé (Oscar Wilde-XXe), Emilie Boulet (Marguerite Audoux), Jean-Luc Bourel (François Villon-Xe), Françoise Boyer (Buffon-Ve), Marie-Caroline Bretillot (Bibliothèque CDML-Ve), Carole Castéra-Tordet (André Malraux-VIe), Aurélia Collot (Françoise Sagan-Xe), Sibylle Cosson (Buffon-Ve), Thierry Chompré (Marguerite Yourcenar-XVe), Eric Cuisset (Italie-XIIIe), Marc Delbos (MMP-Paris Centre), Samuel Desprez (Jean-Pierre Melville-XIIIe), Djamila Derni (Buffon-Ve), Lorraine Deroin (Goutte-d'Or-XVIIIe), Louis Desplechin (Jean-Pierre Melville-XIIIe), Patrick Doncourt-Bandelier (Françoise Sagan-Xe), Solène Dubois (Buffon-Ve), Hervé Duret (Hélène Berr-XIIe), Patrick Engel (Valeyre-IXe), Pascal Faivre (Jean-Pierre Melville-XIIIe), Sébastien Fauque (MMP-Paris Centre), Victor Fouquoire (Germaine Tillion-XVIe), Thomas Frot (Hélène-Berr-XIIe), Yolande Garrido (Violette Leduc-XIe), Agathe Gucciardi (André Malraux-VIe), Gaëtan Hachette (Bibliothèque Hélène Berr-XIIe), Didier Hamon (Place des Fêtes-XIXe), Sandrine Haon (Marguerite Duras-XXe), Neil Hercberg (Georges Brassens-XIVe), Fabrice Lafay-Sorel (Germaine Tillion-XVIe), Marc Lagrange (MMP-Paris Centre), Thierry Lajeunesse (Jean-Pierre Melville-XIIIe), Laudine Lemancel (MMP-Paris-Centre), Blandine lemoine (Violette Leduc-XIe), Frédérique Lemoine (Gutenberg-XVe), Christophe Libouban (Buffon-Ve), Myriam Lomet (Jean-Pierre Melvile-XIIIe), Sophie Luis (Buffon-Ve), Bruno Martin (Italie-XIIIe), François Mary (Jean-Pierre Melville-XIIIe), Maxime Milliet (André Malraux-VIe), Laure Montardy (Buffon-Ve), Cécile Morin (Marguerite Duras-XXe), Karim Moussa (Marguerite Duras-XXe), Céline Muller (Buffon-Ve), Edouard Palis (Jean-Pierre Melville-XIIIe), Elisenda Panadés Inglés (Naguib Mahfouz XXe), Gabrielle Panetrat (MMP-Paris Centre), Catherine Pecassou (Italie-XIIIe), Jean-Claude Peralba (MMP Paris-Centre), Bertrand Pieri (MMP-Paris Centre), Luc Pierin (Marguerite Duras-XXe), Victor Popovic (Oscar-Wilde-XXe), Véronique Portefaix (Marguerite Duras-XXe), Laura Puget (Oscar Wilde-XXe), Freddy Rasolofo (André Malraux-VIe), Carine Robieu (Hergé-XIXe), Linnea Rönnholm (Marguerite Duras-XXe), Rémi Sanchiz (Mohamed Arkoun-Ve), Sylvie Saouma (Helène Berr-XIIe)), Mietek Stanuch (Germaine Tillion-XVIe), Aurélien Stiegler (Batignolles-XVIIe), Jean-Pierre Sutra-Fourcade (Jean-Pierre Melville-XIIIe), Maxime Torté (Germaine Tillion-XVIe), Josée Van Themsche (Germaine Tillion-XVIe), Nicolas Trompette (Violette Leduc-XIe), André Vestry (Violette Leduc-XIe), Mirta Villablanca (Buffon-Ve), Mathieu Villard (Robert Sabatier-XVIIIe). Et aussi en dehors de la Ville de Paris : Marine Cantournet (Médiathèque du Bassin d'Aurillac-Cantal)
Pour signer le texte écrire en envoyant vos noms à l'adresse courriel suivante : socialnecmergitur@yahoo.fr (si vous n'arriver pas à nous écrire, vous pouvez signer en laissant un message dans la rubrique commentaire)
/image%2F1490401%2F20221129%2Fob_ea52c8_ob-88ed69-qa3xn5od-5h2.jpg)
commenter cet article …




/image%2F1490401%2F20220826%2Fob_47c73d_jean-arthur-creff-nouveau-directeur-de.jpg)
/image%2F1490401%2F20210803%2Fob_ee1270_r-1272899-1205465084-jpeg.jpg)
/image%2F1490401%2F20210803%2Fob_867a37_e00ef418b0a0c9005479232025da24f1.jpg)
/image%2F1490401%2F20210617%2Fob_764277_unnamed.jpg)